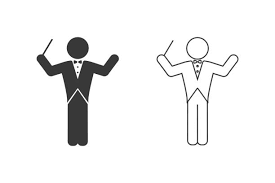Le savoir
occidental tente, depuis vingt-cinq siècles, de voir le monde. Il
n'a pas compris que le monde ne se regarde pas, qu'il s'entend.
Il ne se lit pas, il s'écoute (J.
Attali, Bruits, 2001).
Nous irions donc vers une
société où l'image, la vue seraient dominantes : écrans,
écrans tactiles (toucher l'image), etc. Se perdent
peut-être, dans cette tendance, l'écoute de l'autre, du
monde, et sans doute une forme de tolérance - car voir c'est souvent juger,
par la taille, les traits. Mais ces écrans, on le sait, sont aussi à travers la toile, l'image de notre présent ; cette toile qui touche à nos temps de vie, à nos existences. Cette toile où tout semble abonder à profusion, même les liens - jusqu'à la déréliction.
Nous irions donc vers ce monde où il serait question de gagner du temps - et soulignons que c'est souvent par une machine qu'est apporté ce gain de temps. Pourtant, la pensée, et la pensée artistique en particulier, mûrit comme un fruit : nulle machine ne saurait l'accélérer. Qui oserait abréger des émois ou des sentiments, sous prétexte d'optimiser des opérations mentales?
Nous serions donc lancés dans un vaste processus d'accumulation, peut-être sans fin, de société muséographique en quelque sorte, où tout objet d'art, toute production artistique mériterait d'être archivée, conservée, sanctuarisée. Beethoven, lorsqu'il interpréta en 1792 les 48 Préludes & fugues de J.-S. Bach, ou Mendelssohn lorsqu'il fit rejouer en public la Passion selon Saint-Mathieu en 1829, ne savaient peut-être pas que s'amorçait alors un mouvement dont l'ampleur quantitative laisse aujourd'hui songeur : Il y a plus de choses au ciel et sur la terre, Horatio, que n'en rêve ta philosophie, comme l'écrivait déjà Shakespeare dans Hamlet (Acte I Sc. 5).
Si on admet qu'être cultivé, aujourd'hui plus qu'hier, relève d'un aspect quantitatif, qui oubliera que ce ne peut être qu'en lien étroit avec une exigence qualitative intellectuelle et sensible? On a cru que pour les grandir il suffisait de les vêtir, de les nourrir, de répondre à tous leurs besoins. […] Si on les instruit bien, on ne les cultive plus. Il se forme une piètre opinion sur la culture celui qui croit qu'elle repose sur la mémoire de formules. Un mauvais élève de cours de Spéciales en sait plus long sur la nature et les lois que Descartes et Pascal. Est-il capable des mêmes démarches de l'esprit ? (Antoine de Saint-Exupéry, Terre des Hommes, 1939).
Finalement, pour tenter d'entendre mieux dans ce charivari, peut-être faudrait-il tendre vers
un angle de
pensée et d'écoute
de la musique, et
des arts, certes réfléchi et circonstancié, mais surtout articulé
à d'autres domaines de la pensée comme l'histoire, l'ethnologie, l'éthologie, la sociologie,
la psychologie, les sciences politiques, l'astronomie... sans oublier les domaines de l'action, de l'artisanat, de la paysannerie - tant il est vrai que le dire oblitère le faire, que
l'esprit oublie les mains, ces silencieuses savantes.
Vivre, témoigner de vivre, et l’œuvre d'art viendra ensuite, selon les propres mots de Camus (Les Noces, 1936-37). L'enjeu étant la construction d'un goût artistique, qui puiserait aussi bien aux sources de la philosophie que de toute expérience vécue : transformer en conscience une expérience aussi large que possible (Malraux, L'Espoir, 1937) ; un goût, libre et sincère, qui, tout compte fait, approcherait l'art à travers l'existence, plutôt que l'inverse.
Patrick Lartigue, avril 2023.